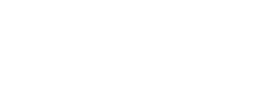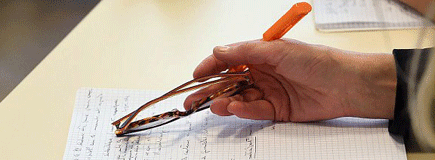Soutenance de thèse de Romain Semenou

24 novembre 202514h
Cnam, 292 rue St Martin, 75003 Paris, Salle
Soutenance de thèse pour l'obtention d'un doctorat en Sciences humaines et humanités nouvelles - spécialité Formation des adultes
La posture d’accompagnateur chez les prêtres formateurs en séminaire : entre socialisation institutionnelle et parcours biographiques
sous la direction de Monsieur Denis LEMAÎTRE
Jury
- M. Denis LEMAÎTRE, Professeur, FoAP et IRENav, Ecole navale : Directeur
- Mme Capucine BREMOND, Maîtresse de conférences, FoAP, Cnam : Co-encadrante
- M. Pascal ROQUET, Professeur, FoAP, Cnam : Président
- Mme Sephora BOUCENNA, Professeure, IRDENa, Université de Namur : Rapporteure
- Mme Maude HATANO-CHALVIDAN, Professeure, LISEC, INSPÉ, Université Strasbourg : Rapporteure
- Mme Céline BÉRAUD, Directrice d'études, CéSor, EHESS Examinatrice
Résumé de thèse
Ces dernières années, les scandales liés à des abus commis par des prêtres ont ravivé les questionnements sur leur formation, centrée sur l’accompagnement spirituel. Placé sous le sceau de la confidentialité, cet accompagnement est assuré tout au long de la formation afin de soutenir le candidat dans son discernement et son intégration progressive à l’ordre des prêtres. Bien qu’ayant évolué pour répondre aux crises récentes, la formation dans les séminaires demeure structurée autour de cet accompagnement. Dans ce contexte, les prêtres accompagnateurs apparaissent comme des acteurs majeurs, engagés dans une démarche professionnelle mêlant exigences institutionnelles, convictions religieuses et expériences personnelles. Cette recherche vise à comprendre comment ces prêtres construisent leur posture d’accompagnateur dans un cadre traversé par de multiples tensions. Elle cherche à éclairer ainsi les pratiques d’accompagnement en formation, en offrant une perspective sur la construction des postures professionnelles, façonnées par des logiques d’engagement liées au rapport à l’institution d’appartenance et aux croyances religieuses. Le recueil des données a été réalisé par des séjours dans trois séminaires et 23 entretiens semidirectifs avec 18 prêtres accompagnateurs spirituels et cinq prêtres supérieurs de séminaire. Ces données ont été traitées par une analyse thématique et des méthodes d’analyse de discours. Les résultats font apparaître la diversité des trajectoires et des logiques d’engagement des accompagnateurs spirituels dans la formation des prêtres. Cinq grandes logiques ont été identifiées : la logique du vécu, la logique de la critique du communément admis, la logique de préservation identitaire, la logique de l’appel, la logique de la grâce d’état. Elles mettent en évidence les tensions et ajustements entre aspirations individuelles et normes ecclésiales, révélant une activité professionnelle façonnée par des convictions et un rapport singulier à l’institution. Sous l’effet combiné de ces logiques, les accompagnateurs spirituels développent des postures différenciées, marquées par leur histoire et leur conception de l’accompagnement. Ces postures traduisent ainsi des positionnements conceptuels qui enrichissent la compréhension des pratiques d’accompagnement, et contribuent à penser l’articulation entre engagement religieux et professionnalité dans les dispositifs de formation.
Mots-clés : accompagnement, posture d’accompagnateur, logiques d’engagement professionnel, formation des formateurs, culture institutionnelle, prêtre catholique, spiritualité.
Abstract
In recent years, scandals involving abuse committed by priests have reignited questions about their training, which focuses on spiritual guidance. This guidance is provided throughout the training program under the seal of confidentiality to support candidates in their discernment and gradual integration into priesthood. Although it has evolved in response to recent crises, training in seminaries remains structured around this guidance. In this context, priest mentors appear to be major players, engaged in a professional approach that combines institutional requirements, religious convictions and personal experiences. This research aims to understand how these priests construct their role as mentors in a context marked by multiple tensions. It seeks to shed light on mentoring practices in training by offering a perspective on the construction of professional roles, shaped by logics of commitment linked to the relationship with the institution to which they belong and to religious beliefs.
Data was collected during visits to three seminaries and through 23 semi-structured interviews with 18 spiritual priests’ directors and five seminary superiors. This data was processed using thematic analysis and discourse analysis methods. The results reveal the diversity of paths and approaches taken by spiritual directors in the formation of priests. Five major logics have been identified: the logic of experience, the logic of criticism of the commonly accepted, the logic of identity preservation, the logic of vocation, and the logic of state grace. They highlight the tensions and adjustments between individual aspirations and ecclesial norms, revealing a professional activity shaped by convictions and a unique relationship with the institution. Under the combined effect of these logics, spiritual guides develop differentiated postures, marked by their history and their conception of guidance. These postures thus reflect conceptual positions that enrich the understanding of guidance practices and contribute to thinking about the articulation between religious commitment and professionalism in training programs.
Keywords : support, support role, professional commitment, trainer training, institutional culture, Catholic priest, spirituality.

24 novembre 202514h
Cnam, 292 rue St Martin, 75003 Paris, Salle