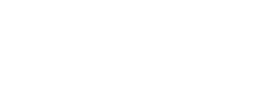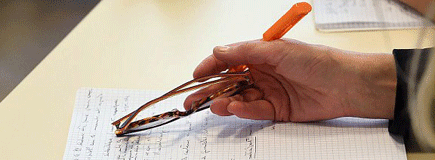Thématique 1 : Professionnalisation, Langage et Numérique
 Les champs investis
Les champs investis
Les recherches menées dans le cadre de la thématique 1 se situent à l’interface du triptyque « Professionnalisation, Langage et Numérique ». Elles visent d’une part à mieux comprendre la nature des interactions qui se jouent entre ces trois variables. Elles nourrissent d’autre part la réflexion autour des places et des rôles que le langage et le numérique peuvent occuper dans les processus de (pré)professionnalisation et la formation professionnelle.
Enjeux épistémologiques
Dans ce triptyque, le terme de « professionnalisation » renvoie aux processus de transformation des formations déployés pour œuvrer à la fabrication des professionnels (Wittorski, 2008). Depuis quarante ans, on assiste en effet à une multiplication des injonctions politiques et patronales pour réformer les cursus : approche par compétences, implication accrue des professionnels, apprentissage en situation de travail (stages, alternance), parcours doctoraux, etc. Pour autant, l’efficacité de ces pratiques est questionnée face à l’évolution rapide des emplois et des trajectoires professionnelles. Cette situation soulève des interrogations sur les savoirs à transmettre comme sur les méthodes à privilégier pour assurer une professionnalisation durable et autonome.
Parallèlement à cela, le pôle « langage » du triptyque concerne les capacités liées au savoir « lire-écrire-parler-communiquer » (Filliettaz, 2022 : 266). Ces dernières peuvent conduire à mettre en jeu une variété de modes sémiotiques (Kress, 2019), de langues, de pratiques ou de registres langagiers. En tant que telles, elles appellent à interroger trois angles d’étude prioritaires : les compétences langagières en tant que (i) enjeux de formation, (ii) moyen de formation et (iii) modalités méthodologiques de production / analyse de données.
Le pôle « numérique » enfin, est à la fois envisagé en tant qu’enjeu (apprendre à utiliser des outils numériques pour le travail) et moyen (se former via des outils numériques) de formation.
Aux confins de ces trois pôles se dégagent deux objectifs génériques de recherche dont les membres de la Thématique 1 entendent s’emparer.
Objectifs de recherche
1. Les pratiques langagières à l'oeuvre en contexte (numérique) de travail
Depuis les travaux fondateurs du réseau Langage et Travail, de nombreuses recherches ont permis de caractériser les pratiques langagières dans une diversité de situations (Borzeix & Fraenkel, 2001 ; Boutet, 2001). Les questionnements restent cependant nombreux en ce qui concerne les dispositifs didactiques permettant de favoriser le développement de compétences langagières et communicationnelles en lien avec divers types de pratiques et de situations professionnelles.
Dans ce contexte, une première piste de recherche concerne l’étude du développement des compétences langagières en anglais chez des adultes professionnels engagés dans la formation tout au long de la vie, ce bagage étant de plus en plus essentiel pour eux sur le marché du travail mondialisé d’aujourd’hui (The Douglas Fir Group, 2016 ; OCDE, 2019).
Un autre axe d’étude porte sur la caractérisation des dimensions multimodales de la communication dans les dispositifs numériques de travail : ceux qui intègrent des dimensions informelles (le “wild”) en particulier.
Une piste complémentaire a trait aux compétences requises pour collaborer à distance dans des équipes plurilingues et pluriculturelles de travail car pouvoir mobiliser un répertoire plurilingue en contexte numérique est loin d’aller de soi. Cette situation soulève donc des besoins de formation qu’il s’agit de cerner et satisfaire auprès des professionnels.
Un autre centre d’intérêt touche à l’analyse de discours professionnels spécialisés à des fins d’enseignement : pour identifier les caractéristiques de ces discours et élaborer en retour des dispositifs de formation susceptibles de les promouvoir auprès des apprenants.
Enfin, une partie des recherches se focalise sur l’analyse des processus de négociation de sens / coopération à l’œuvre dans les situations professionnelles où se déploient des pratiques interactionnelles relevant de la « communication managériale ». Ces questionnements visent à appréhender les pratiques langagières des personnels encadrants, à cartographier les compétences de communication auxquelles elles font appel et à déterminer à quelles conditions elles pourraient être intégrées dans des dispositifs de formation dédiés, en vue de les promouvoir.
2. Le langage comme moyen de formation dans les dispositifs faisant appel ou non au numérique
Cette orientation envisage le langage comme une ressource à mobiliser pour réaliser certaines activités de formation.
Un premier axe porte ainsi sur le langage (oral, écrit) en tant qu’instrument privilégié de médiation de l’expérience vécue (Merhan, 2011) : dans les situations professionnalisantes en particulier. Dans cette optique, des retours d’expérience collectés auprès d’apprentis pourront faire l’objet d’une attention particulière.
D’autres questionnements viseront à approfondir les pratiques d’enseignement-apprentissage à l’œuvre dans des espaces « intermédiaires » de formation, c’est-à-dire situés à l’interface entre mondes académique et professionnel. Il sera alors plus particulièrement question de se concentrer sur la communication multimodale, l’usage des supports écrits (fiches TP, documentation technique) et les apports / limites liés au recours à la littératie hybride (combinant registres scolaires et professionnels) dans les fermes et ateliers technologiques des lycées agricoles.
Le langage joue enfin un rôle central dans la recherche, que ce soit pour produire des données (questionnaires, entretiens, observations, focus groups, récits, vidéos, etc.) ou les analyser (analyse thématique, de contenu, de discours, etc.). Cette diversité méthodologique interroge la place du chercheur, tant sur le plan de l’aide apportée pour mettre en mots les vécus dont les données rendent compte que sur celui des médiations proposées pour y parvenir.
Programme 2025-2026
- Démarrage d’un centré sur la remédiation linguistique personnalisée par le biais de l’intelligence artificielle, lauréat de l’Appel à Projets Pédagogiques Innovants (Campagne 2025)
- 16 janvier 2026 : Journée d’étude « Intelligence artificielle et mutations du travail : quels enjeux pour la formation et la professionnalisation ? »
- Coordination d’un numéro spécial dans Le Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée (n°123) : “La compréhension de l’oral en langue étrangère : défis et pistes didactiques”.
- Coordination d’un numéro spécial dans la revue Phronesis: “Multimodalité dans la communication pour l’agir professionnel : repérage et analyse”.
- Coordination d’un numéro spécial dans la revue ASp – La revue du GERAS (n°88) : “Anglais de spécialité et numérique / ESP and digital technologies”.
- Séminaire organisé par le réseau Ingénium (https://reseau-ingenium.fr/) : “IA générative et formations ingénieur·e.s : quels sens, quels usages, quels enjeux et responsabilités pour les SHS ?” (11/12/2025, Cnam Paris)
- Coordination d’un numéro spécial dans la revue Lexis, portant sur les transferts lexicaux et les formes lexicales atypiques dans les corpus d’apprenants de L2
Année 2024-2025
- Démarrage du Projet Erasmus+ « IN-4-STEM » sur l’intégration et le bien-être des élèves ingénieurs (depuis janvier 2025) avec la réalisation des études qualitatives concernant l'insertion des élèves dans les écoles d'ingénieurs (plus d'information sur le site web du projet : https://in-4-stem.eu/)
- Séminaire international sur l'usage de l'intelligence artificielle pour l'enseignement-apprentissage des langues (juin 2024)
- Conférence de Matthieu Petit, vice doyen à la formation et professeur titulaire au département de pédagogie de la faculté d'éducation de l'université de Sherbrooke. "Présence à distance en télésupervision de stage : modélisation, considérations éthiques et exemples de dispositifs d'accompagnement de stagiaires" (7 avril 2025).
- Co-organisation de la conférence 2025 du réseau GELS "The S in GELS : Exploring Communication and Skills for Engineers GELS2025" - 25-27 juin 2025 (https://gels2025.sciencesconf.org/)
- Conférence de Consensus du CNESCO en novembre 2024 “Nouveaux savoirs nouvelles compétences chez les jeunes” avec notamment l’intervention de Pierre-Yves Oudeyer s’intéressant aux enjeux sociétaux et éducatifs de l’intelligence artificielle (IA) mais aussi d’Even Loarer sur les compétences non académiques qui sont attendues des jeunes sur le marché de l’emploi et enfin Ariane Fréhel présentant la manière dont le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) conçoit des formations pour adultes et jeunes adultes prenant en compte les évolutions du monde du travail (https://www.cnesco.fr/fr/savoirs-et-competences-des-jeunes/)
- France compétences sur l’alternance
- Participation au comité d’organisation de la biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles intitulée « Faire expériences » et qui aura lieu les 22, 23, 24 avril 2026 au Cnam (St Martin).
- Co-organisation d’une journée d’étude en lien avec la question du frottement des métiers dans le cadre du projet HERCULE 4.0 "Ateliers du faire"
- Co-organisation d’une journée d’étude à L’institut Agro Rennes-Angers (juin 2025) sur “ Innovation pédagogique et frottements de métiers” et participation à la table ronde (https://jetip2025.sciencesconf.org/)
- Démarrage du projet AgroOpenLab (Projet ANR Compétences et Métiers d’Avenir) et pilotage de l’Action 3 “Identification des métiers et des compétences en cours de transformation” (https://agroopenlab.fr/a-propos/agro-open-lab).
- Co-organisation du colloque QPES
Année 2023-2024
Séances plénières
Invitation de chercheurs internationaux
Pr. Marie-Josée Hamel (The University of Ottawa, Canada)
Dr. Antonie Alm (The University of Otago, New Zealand)
20 juin 2024 (en présentiel, 2 rue conté Cnam Paris 3e, Salon d'honneur, 1er étage)
Séminaire International de recherche
Partage des résultats du Cnesco
Par Jean-François Chesné sur le thème du bien être à l’école (date à fixer).
Projets en cours
Communication et multimodalité dans l’action professionnelle
Projet inter-thématique pluriannuel subventionné par le LabEx haStec, porté par Muriel Grosbois et Naouel Zoghlami
10 novembre 2023 (en présentiel au Cnam Paris)
Journée d'étude internationale
2024
Publication d’un numéro spécial dans une revue en Sciences de l'Éducation et de la Formation
Approches évaluatives de dispositifs doctoraux : apports pour la recherche et pour l'action
Projet porté par Elsa Chachkine
14 novembre 2023 (en présentiel au Cnam Paris)
Journée d'étude pour partager les premiers résultats, échanger avec les doctorants, les praticiens et les chercheurs du domaine
23 janvier 2024, 14h-15h30 (Teams)
Présentation du projet « Se regrouper pour rédiger : trois dispositifs d’accompagnement québécois pour soutenir les apprentis-chercheurs dans leur professionnalisation » et échanges sur le recueil et l’analyse des données.
Mardi 26 mars 2024, 14h-15h30
Présentation du projet « Comparaison des effets de deux dispositifs d’accompagnement à la rédaction de thèse sur la professionnalisation scientifique et la santé psychologique de doctorants » et échanges sur le recueil et l’analyse des données.
Mardi 14 mai 2024, 14h-15h30
Présentation du projet « Dimensions idéelles et vécues d’un dispositif de formation qui professionnalise à la recherche : évaluation du parcours doctoral de l’ED Abbé Grégoire » et échanges sur le recueil et l’analyse des données.
3-5 juillet 2024
Symposium du REF à Fribourg avec un collectif de chercheurs élargi.
Télécollaboration plurilingue : collaborer à distance pour résoudre des problèmes complexes dans plusieurs langues
Projet porté par Elsa Chachkine
Septembre 2024
Journée d’étude sur les télécollaborations plurilingues qui présente les résultats des expérimentations 1 et 2 dans différents contextes.
Année 2022-2023
Communication et multimodalité dans l’action professionnelle
Projet inter-thématique pluriannuel subventionné par le LabEx haStec, porté par Muriel Grosbois et Naouel Zoghlami
14 novembre 2022 (Teams)
Échanges autour de la demande de financement au Labex Hastec, le choix d’un invité international, l’avancement de nos recherches respectives, le support de publication
17 mars 2023 (Teams)
Organisation de journée d’étude
7 juillet 2023 (en présentiel)
Journée préparatoire à la journée d’étude avec discussion sur les points méthodologiques et théoriques saillants de nos recherches respectives, la rédaction de l’appel à publication.
Approches évaluatives de dispositifs doctoraux : apports pour la recherche et pour l'action
Projet porté par Elsa Chachkine
27 février 2023 (Teams)
Échange sur les dispositifs doctoraux à évaluer, discuter les concepts-clés du projet : dispositif, professionnalisation, évaluation.
24 avril 2023 (Teams)
Présentation des protocoles de recherche. Mise en commun d’un guide d’entretiens et d’un questionnaire pour certaines recherches.
19 juin 2023 (Teams)
Échange sur les données récoltées, les analyses envisagées.
Atelier « Méthodologies d’appréhension des effets des dispositifs de formation »
Porté par Aude Labetoulle
25 novembre 2022
Échanges autour des concepts et outils-clefs mobilisés par les chercheurs dans le cadre de leur analyse des dispositifs de formation.
Identification d’un axe sur lequel se focaliseront les travaux à venir : les méthodologies d’appréhension des effets des dispositifs de formation.
10 janvier 2023 & 14 février 2023 & 26 mai 2023
Présentation de dispositifs de formation et de méthodologies d’analyse à partir d’un document rempli collectivement.
Présentations d’éléments théoriques ou méthodologiques en lien avec les questions d’appréhension des effets des dispositifs.
Année 2021-2022
30 septembre 2021
Définition des activités de la Thématique 1 à mener sur l'année 2021-2022 : mise en place de groupes de travail :
- Communication multimodale
- Ingénierie de formation
- Apprentissage en période de confinement
Atelier « Communication multimodale »
Porté par Muriel Grosbois et Naouel Zoghlami
28 octobre 2021
Atelier à l’échelle de la thématique 1 - Identité
20 novembre 2021
Atelier à l’échelle de la thématique 1 - Identité et positionnement au niveau national
2 décembre 2021
Atelier à l’échelle de la thématique 1 - Identité et positionnement au niveau international
28 mars 2022
Atelier à l’échelle inter-thématique - Définition d’un objet commun : Communication et multimodalité dans l’action professionnelle
7 juin 2022
Atelier à l’échelle inter-thématique. Échanges autour des projets de recherche en cours par les membres du groupe
Octobre 2022
Dépôt d’une demande de subvention au Labex Hastec par Muriel Grosbois et Naouel Zoghlami pour une journée d’étude prévue en 2023 : « Communication et multimodalité dans l’action professionnelle ».
Atelier « Ingénierie de formation »
Porté par Aude Labetoulle
2 juin 2021
Présentation des recherches menées par Aude Labetoulle aux membres de la thématique 1.
Atelier « Apprendre et enseigner en situation de contrainte dans l’enseignement supérieur »
Porté par Anne Jorro
28 octobre 2021
Validation du choix d’organiser un séminaire de recherche et d’inviter Annie Jézegou
2 décembre 2021
Discussion sur les recherches qui seront présentées lors de ce séminaire
31 janvier 2022
Préparation du programme et de l’affiche
2 et 15 mai 2022
Derniers ajustements du séminaire de recherche
16 juin 2022
Séminaire de recherche « Apprendre et enseigner en situation de contrainte dans l’enseignement supérieur » au Cnam
Année 2020-2021
25 septembre 2020
Travail collectif sur le texte définitoire et sur le volet "savoirs professionnels et compétences".
5 novembre 2020
Préparation de la présentation des travaux menés au sein de la thématique, pour l'assemblée générale du laboratoire.
Point sur le colloque international EUROCALL 2021 : "CALL & professionalisation".
29 janvier 2021
Organisation des séances d'ici l'AG de juin 2021
- Klara Kövesi : présentation du projet Erasmus+ A-STEP 2030 Attracting DiverSe Talent to the Engineering Professions of 2030 portant sur l'innovation dans le domaine de la formation des ingénieurs.
4 mars 2021
Etude d'une proposition de collaboration internationale sur le thème de la simulation et des données massives
- Natacha Dangouloff : présentation de sa recherche doctorale portant sur la simulation et la formation d’adultes.
7 mai 2021
Présentation des méthodologies de recherches qualitatives menées par :
- Elsa Chachkine et Aude Labetoulle
- Fabienne Saboya (recherche conduite avec Anne Jorro)
- Anaïs Loizon
11 juin 2021
Préparation des interventions lors de l'Assemblée générale
- Jean-François Chesné : présentation des résultats de la conférence du Cnesco sur la formation continue.
Année 2019-2020
10 septembre 2019
Travail collectif pour l’organisation de la réunion inter thématiques du laboratoire du 4 octobre 2019
- Jamila Al -Khatib : présentation d'une étude exploratoire sur l'usage du numérique au musée
28 novembre 2019
Organisation du travail collectif pour 2020 suite à l'AG d'octobre 2019.
- Jean Frances : présentation de ses travaux sur les réformes du doctorat depuis les années 2000, en explorant plus particulièrement les Doctoriales et le concours « Ma thèse en 180 secondes ».
13 mai 2020
Travail collectif autour des concepts de savoirs, compétence(s) et dispositif(s).
- Anne Jorro : présentation du projet de recherche international « Epreuve, mise en tension et inventivité des étudiants de 2e et 3e cycle en situation de confinement ? »
4 juin 2020
Présentation des travaux de recherche par les doctorants
Travail collectif sur la mise à jour du texte définitoire la thématique
Année 2018-2019
7 septembre 2018
Présentation des travaux de recherche par les participants de la thématique
18 octobre 2018
- Aude Labetoulle : présentation du dispositif LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines) étudié sous l’angle d’un système dynamique complexe.
8 novembre 2018
Travail collectif sur le texte définitoire de la thématique
- Caroline Arnoux : présentation de sa recherche "Scénario pédagogique pour penser l'histoire autrement : une expérimentation au collège".
- Elsa Chachkine : présentation de sa recherche "Le tournant social des dispositifs d’apprentissage des langues en semi-autonomie, le cas du russe en télétandem et sur les réseaux sociaux".
- Catherine Tourette-Turgis et Cynthia Fleury : présentation de leurs recherches sur "l'apprenant vulnérable"
6 décembre 2018
Travail collectif sur le texte définitoire de la thématique
- Naouel Zoghlami Terrien et Muriel Grosbois : présentation du projet pilote "Télétandem Cnam Paris – Université de Cardiff"
17 janvier 2019
Travail collectif sur le texte définitoire de la thématique
- Caroline Arnoux et Elsa Chachkine, Anne Jorro : présentation des projets de recherches Labex Hastec
- Michèle Debrenne, professeure en linguistique appliquée à l’université de Novossibirsk : présentation de ses deux projets de recherche "les associations évoquées par les mots" et "les marques du bilinguisme dans les carnets intimes d’une princesse russe du 18e siècle".
21 mars 2019
Définition des mots clés pour la thématique
- Anne Jorro : présentation des ses travaux de recherche sur le concept de transmission
- Anaïs Loizon, Nathalie Droyer, Dominique Guidoni-Stoltz, Marie David : présentation du projet "Agreencamp"
16 mai 2019
Travail collectif pour l’organisation de la réunion inter thématiques du laboratoire du 4 octobre 2019
- René Bagorski : présentation de ses travaux dans le domaine de la conception des politiques de formation.
- Muriel Grosbois : réflexion sur la communication multimodale - concepts et enjeux
Réunions 2025/2026
- 06 novembre 2025, 11h00 - 12h00 (à distance)
- Deux demi-journées de travail se tiendront avant et après les vacances de Pâques (Les dates seront publiées très prochainement...)
Thématique 1
Responsable
Cédric Brudermann (PU)
Enseignant.e.s- chercheur.e.s
Nathalie Droyer (MCF), Cynthia Fleury-Perkins (PRCM), Muriel Grosbois (PU), Klara Kovesi (MCF), Anaïs Loizon (MCF), Aude Labetoulle (MCF), Florian Malaterre (MCF), Cécile Plaud (MCF), Laurent Veillard (PU), Naouel Zoghlami Terrien (MCF)
Docteur.e.s
Maher Abdessater, Colette Casimir, Natacha Dangouloff, Caroline Fairet, Evelyne Rosalie, Adeline Rouleau, Amélia Rus-Rucart, Victoria Zolnowski-Kolp
Ingénieures et PAST
Doctorant.e.s
Nathalie Nasr, Marie Tesson
Membres associé.e.s